chapitre XXXI (extraits)
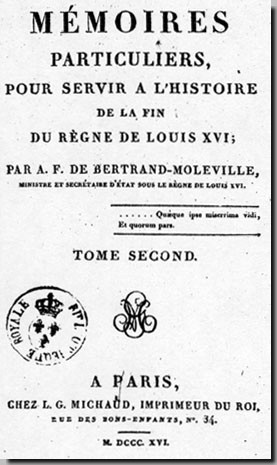
extraits du chapitre XXXI
(Je me détermine à sortir du royaume ; Mme de Flahaut me procure un passeport du département des affaires étrangères, renvoyé par un émigré qui n’en avait pas eu besoin ; son ancienneté me donne de l’inquiétude ; j’en fais moi-même un autre dans la nouvelle forme. – Précautions et détails relatifs à mon départ.)
p.225 à 229
J’étais encore indécis sur le parti que je prendrais, lorsque les moyens de sortir du royaume me furent offerts par une femme, que ses liaisons ont fait juger trop sévèrement, et qui, malgré tout ce qu’on en a pu dire et penser, était sincèrement dévouée au roi. C’est Mme de Flahaut dont je veux parler, et à qui, toute reconnaissance à part, je dois la justice de déclarer ici que, pendant mon ministère, et jusqu’au 10 août, elle a été de la plus grande exactitude à me faire part de tout ce qu’elle apprenait, qui pouvait intéresser le roi, et que j’ai dû souvent à son zèle des renseignements très utiles à Sa Majesté. Dans cette circonstance, elle s’adressa à mon frère le chevalier, qu’elle ne connaissait pas, pour me faire parvenir le conseil de sortir du royaume le plus tôt possible, et d’aller en Angleterre avec un passeport qu’elle me fournirait ; elle se chargeait aussi de me faire arriver sans le moindre danger à Boulogne-sur-Mer, et de m’adresser dans cette ville à un correspondant intelligent et sûr, qui avait déjà fait embaquer deux de ses amis sous des noms supposés, et qui me rendrait le même service.
J’acceptai avec empressement les propositions de Mme de Flahaut, sauf à examiner les moyens d’exécution. Mon frère, que je chargeai de lui faire cette réponse, me rapporta le passeport qu’elle me destinait ; il avait été expédié au département des affaires étrangères pour un de ses amis, qui l’avait payé cent louis, et qui, s’étant embarqué sans le faire viser, parce qu’on avait négligé de le lui demander, le lui avait renvoyé pour qu’elle en disposât en faveur d’un autre ami. Ce passeport avait déjà près de deux mois de date, et il avait été expédié dans une forme toute différente de celle qu’on avait adoptée depuis : il y avait d’ailleurs quelques grattages et corrections à faire, pour changer le signalement qui y était exprimé, et y substituer le mien ; mais mon valet-de-chambre étant très expert dans cette partie, et ayant une écriture à peu près pareille à celle du passeport, cet article m’inquiétait beaucoup moins que l’ancienneté de la date. Quant aux moyens d’arriver en sûreté à Boulogne, Mme de Flahaut me proposait de m’y faire conduire par un ancien domestique de sa famille, à qui elle avait procuré une place de courrier de la malle sur cette route, et qui me prendrait dans sa brouette aux environs de St-Denis.
Cette proposition me parut si avantageuse, qu’elle me détermina à partir malgré toutes les inquiétudes que la forme et l’ancienneté du passeport pouvaient me donner : en conséquence, le 12 octobre fut le jour définitivement fixé pour mon départ. J’avais encore six jours d’intervalle pour me préparer à ce voyage, et j’en profitai pour me faire moi-même, sur du papier de la nouvelle formule, un passeport absolument conforme à ceux qui s’expédiaient alors, et dont on m’avait procuré un modèle. Le danger de traverser Paris, et d’en sortir en plein jour, était le seul que j’avais encore à craindre ; ma famille, qui en était fort alarmée, imagina que je ne pouvais éviter d’être reconnu qu’en m’affublant d’une vieille perruque bien noire, et bien mal peignée.
Après avoir couru tous les perruquiers et revendeurs de vieilles perruques, on en trouva enfin une telle qu’on la désirait, et on vint me l’essayer. Il est certain qu’elle me changeait si horriblement, qu’il n’était pas possible qu’on me reconnût, mais elle avait en même temps l’inconvénient de rendre ma figure si remarquable, qu’il était impossible que la première patrouille ou sentinelle qui apercevrait une coiffure aussi extraordinaire et aussi ridicule, ne la regardât pas comme un déguisement, et ne m’arrêtat pas comme personne suspecte. Cette considération me décida à rejeter la perruque, et à n’employer d’autre déguisement qu’une coiffure très négligée, un chapeau rond et une redingotte brune. Tel fut en effet le costume avec lequel je partis en fiacre, de chez mon hôte, le vendredi 12 octobre, à dix heures du matin. J’avais quatre compagnons de voyage, dont l’un était M. Thomas en uniforme de bas-officier national, les trois autres ne me connaissaient pas, et l’un d’eux était aussi en uniforme. J’avais envoyé la veille mon sac de nuit au conducteur de la malle de Boulogne, et je n’emportais avec moi que des viandes froides et du vin pour notre dîner, afin qu’en cas d’arrestation, on ne trouvât rien dans notre voiture qui fit soupçonner des projets de départ ; nous étions convenus de répondre, si nous étions arrêtés et interrogés, que nous allions dîner à Pierrefitte, près St-Denis, pour voir une maison qui était à vendre. Nous arrivâmes, sans la moindre rencontre fâcheuse, à ce petit village qui est à un quart de lieue au-delà de St-Denis ; j’y dînai chez un vieux architecte italien, dévoué à Mme de Flahaut, qui m’avait fait donner le conseil d’aller attendre chez lui l’arrivée de la malle de Boulogne. Je me rendis sur la grande route quelques moments avant l’heure à laquelle le courrier, qui devait me conduire, m’avait fait dire qu’il passerait à la hauteur de Pierrefitte ; il arriva presque en même temps que moi, et m’ouvrit sa brouette, où j’eus bien de la peine à entrer, parce qu’il en remplissait les trois-quarts, et que j’avais encore plus d’embonpoint que lui. Il en résulta que nous fimes ce voyage fort mal à notre aise ; je n’aurais même pas pu y tenir, s’il eût été plus long, et si mon conducteur n’avait pas eu l’heureuse habitude de descendre à chaque poste pour boire son petit verre d’eau-de-vie ; je profitais de ces moments de répit pour respirer plus librement, et pour soulager un peu mes bras et mes jambes, que la compression violente qu’ils éprouvaient entretenait dans un engourdissement continuel.
J’arrivai à Boulogne dans la nuit du samedi au dimanche, et je descendis à l’auberge de la poste, si moulu de fatigue et de contusions, que je ne pouvais presque pas me tenir sur mes jambes. Je demandai bien vite une chambre, car, quoique je n’eusse pas mangé la valeur de quatre onces de pain dans toute la route, le besoin d’un lit était pour moi le plus pressant de tous.
Le lendemain matin, je n’eus rien de plus pressé que d’écrire à M. Menneville, citoyen de Boulogne, à qui Mme de Flahaut m’avait recommandé, sous les noms et qualités de Vandeberq, négociant liégeois, que j’avais pris dans mes passeports ; je lui annonçais mon arrivée, le désir que j’avais de profiter du premier paquebot pour passer en Angleterre, et je le priais de passer chez moi à sa première sortie, pour convenir des arrangements pour mon départ…
p.234
… Le mauvais temps se soutint encore pendant cinq jours que je passai soigneusement renfermé dans ma chambre, pour ne pas m’exposer à rencontrer quelqu’un qui me reconnût. Je voyais seulement une à deux fois par jour M. de Flahaut qui s’était réfugié à Boulogne, et un vieux gentilhomme de ses amis, qui devait partir avec moi, pour se rendre de Douvres à Ostende, et de là en Allemagne.
Le 19 octobre, la pluie qui n’avait pas discontinué depuis cinq jours que j’étais à Boulogne, cessa ; le vent tomba entièrement, et le soleil le plus brillant nous annonçait une des plus belles journées d’automne. A neuf heures du matin, M. Menneville me fit donner avis que le paquebot sur lequel il m’avait arrêté une place, devait mettre à la voile entre dix et onze heures. Il m’envoya une personne de confiance pour me conduire au porrt, et me faire connaître mon paquebot. J’y arrivai et j’y montai sans avoir trouvé personne sur mon chemin, qui m’eût demandé mon passeport ; ainsi, j’aurais pu, sans inconvénient, m’épargner la peine que je m’étais donnée pour le fabriquer, et pour le faire viser. Ce ne fut qu’à midi précis que nous eûmes la joie extrême de voir nos voiles légèrement agitées, s’enfler peu à peu, autant qu’il le fallait pour nous faire gagner le large. Il me sembla d’abord que je respirais plus librement que je ne l’avais fait depuis longtemps ; mais, à mesure que je voyais la terre de France s’éloigner de mes yeux, je sentais mon coeur se serrer, et, quand je cessai de la voir, la pensée de fuir comme un proscrit… sous un nom supposé… celle encore plus déchirante d’être réduit, pour sauver ma vie, à me séparer… peut-être pour jamais… de tout ce qui me la rendait chère, vinrent m’agiter et m’oppresser à la fois, un frisson intérieur me saisit… Des larmes involontaires coulèrent de mes yeux… J’étais au désespoir.
